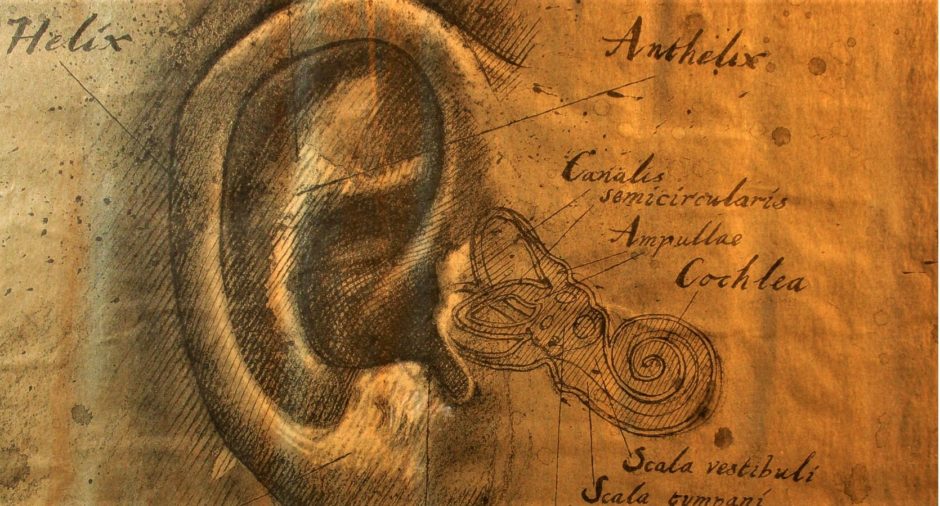Argument : Sous sa forme désormais de « lettre ouverte » à un lecteur possible, ce texte rédigé initialement en 1997 en prévision d’une conférence qui n’eut pas lieu, traite en premier lieu du problème que pose la psychanalyse pratiquée « hors cure ». Dans la psychanalyse française, le « hors cure » est un euphémisme qui permet de tourner l’expression de « psychanalyse appliquée » qu’emploie Freud. En fait, la psychanalyse pratiquée hors cure par l’analysant (du texte) / analyste revient encore le plus souvent à une cure « exportée » ou « transposée » du patient pris pour objet d’analyse par le « moi » de l’analysant / analyste. Or quand l’analysant / analyste parle de l’autre « patient » lors d’une communication ou à l’occasion d’une publication, le patient en question est « parti » (fort). Il est en voyage dans le temps, parfois depuis des siècles s’il porte un nom illustre en tant qu’artiste ou écrivain. Dans La question de l’analyse profane (1926) c’est à dire « pratiquée par des laïcs » (Laienanalyse), Freud ne considérait pas que la pratique de la psychanalyse dût se limiter à la seule application clinique de cette nouvelle science. Revisitée environ seize ans plus tard, mon étude sur le problème de définition de la psychanalyse hors cure et de la reconnaissance institutionnelle de cette pratique, débouche – encore assez obscurément dans ma recherche d’alors – sur une interrogation métapsychologique quant aux rapports du « moi », objet d’amour du narcissisme, et du « mythe » d’Œdipe dont l’Homme est le héros : porté socialement au pouvoir abusif de sa représentation dans le genre masculin « hom(m)osexuel » refoulé de « tout » le genre humain.
-
Je me méfie de tous les gens à systèmes et je les évite. La volonté de système est un manque de probité.
F. Nietzsche: Le crépuscule des idoles. 1888.
Abonnez-vous à ce blog par courriel.
-
Articles récents
- Pierre Fédida & Patrick Lacoste : « Psychopathologie / Métapsychologie. La fonction des points de vue » fin
- Pierre Fédida & Patrick Lacoste : « Psychopathologie / Métapsychologie. La fonction des points de vue » Ière partie
- Les TDAH et l’affreux Jojo de Dolto
- Joël Bernat : « L’amour « expérimental », 3ème partie : La préhistoire « refoulée » du contre-transfert : le Gegenliebe
- Sándor Ferenczi : « Masculin et féminin »
- Joël Bernat : « L’amour « expérimental » dans la cure psychanalytique, ou du divan au canapé : collusions fantasmatiques et contre-transferts » 2ème partie : Freud et l’invention du contre-transfert : Gegenübertragung
- Martine Bucchini-Giamarchi : « Freud et les jeunes filles Problème de technique psychanalytique ou problème de contre-transfert »
- Joël Bernat : « La vision-du-monde de Wilhelm Reich »
- Joël Bernat : « Quelques fondamentaux de la pensée de Sigmund Freud »
- J.B. Pontalis : « le self et le moi »
- Serge Lebovici : « Naître et l’écriture »
- Joël Bernat : « Freud, la religion et ses Moïses »
- Pierre Delmas : « Psychanalyse et neurosciences : deux disciplines qui ne s’excluent pas »
- Javier Diaz II : « L’être et le temps, qu’est-ce que l’homme ? »
- Javier Diaz I : « L’être et le néant. Progrès ou adaptation ? »
- Joël Bernat : « L’amour « expérimental » dans la cure psychanalytique, ou du divan au canapé : collusions fantasmatiques et contre-transferts » 1ère partie
- L’avis éclairé de Sigmund Freud sur la Palestine et Israël
- Pierre Fédida : Psychanalyse et biologie
- Sur les groupes humains et institutions : l’oligarchie vue par Robert Michels (1876-1936)
- Jean-Claude Lavie : « L’amour ne s’autorise que de lui-même »