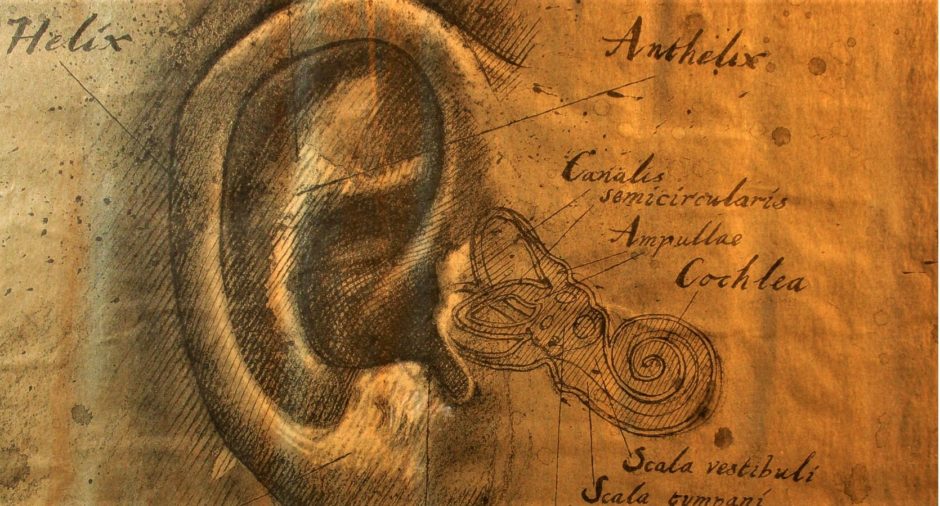(Séminaires année 2000, Bordeaux & Nancy & Luxembourg 2002)
voir : http://www.dundivanlautre.fr/sur-la-psychanalyse-et-le-psychanalyste/joel-bernat-lamour-experimental-dans-la-cure-psychanalytique-ou-du-divan-au-canape-collusions-fantasmatiques-et-contre-transferts-1ere-partie
« Ils étaient assis dans la même pièce, mais pas dans le même monde. » Aldous Huxley[1]
1 : D’abord, le transfert comme outil
Dans l’ordre des découvertes, celle du transfert est première, et sous la forme de l’énamoration[2], c’est-à-dire du transfert qualifié de « positif » (la forme dite « négative », celle du transfert haineux, est découverte bien après). Freud emploie en ce cas le terme de Verliebtheit qui n’est pas l’amour, mais la passion amoureuse ou l’énamoration, également utilisé pour parler de l’amour de transfert.
a : Le transfert amoureux comme part animale et obstacle au travail analytique
Dès 1895, dans les Études sur l’hystérie[3], Freud rapporte la mésaventure d’une patiente qui avait eu jadis le souhait
« …aussitôt renvoyé dans l’inconscient, que l’homme avec lequel elle avait eu alors une conversation y aille de tout son cœur et lui impose un baiser. Voici qu’une fois, une séance étant terminée, un tel souhait émerge chez la malade concernant ma personne elle en est épouvantée, passe une nuit sans sommeil et se trouve la fois suivante, bien qu’elle ne refuse pas le traitement, tout à fait inapte au travail ».
En fin de compte, il s’avère qu’à la suite de la séance de la veille, avait surgi en elle un souhait semblable concernant cette fois-ci la personne de Freud. Elle en est horrifiée. Et Freud de conclure que :
« Le transfert sur le médecin se fait par fausse connexion ».[4]
Mais cette fausse-liaison, résultant d’une projection, et c’est cela qui fait transfert, révélera qu’elle sert un but, celui d’une emprise : ce n’est pas une simple « erreur » !
« Ils (les patients) voudraient, avec leur passion dégagée de tout lien social, tenir à merci le médecin ».
Ce souhait d’emprise, de prendre ou reprendre « la main » sur l’analyste (nous serions là dans un rapport de force), a plusieurs origines, mais Freud en relève une bien particulière lorsqu’il écrit :
« Je veux parler des femmes à passions élémentaires, que des compensations ne sauraient satisfaire, des enfants de la nature, qui refusent d’échanger le matériel contre le psychique ».
C’est-à-dire qu’il y aurait ici, si l’on prend les choses au premier degré, une affaire de niveau culturel et donc de capacités d’élaboration, qui servirait d’opposition à ce que réclame la cure telle qu’elle est pensée à cette époque : un minimum de capacités intellectuelles. C’est ce qui s’est souvent dit et qui réserverait l’analyse aux seuls gens cultivés… Interprétation peu analytique, que Freud corrigera des années plus tard avec la notion de « haine de la culture » : soit le refus actif d’élaboration psychique du pulsionnel afin d’en rester à la satisfaction immédiate des pulsions et non différer la satisfaction ou la sublimer. Cet enjeu de culture indique seulement que pour qu’il y ait élaboration et perlaboration, il est requis un minimum d’outils de pensée.
Revenons à ce moment où Freud forge un tableau clinique de patiente qui, soudain tombée tout entière sous l’emprise de la « partie animale de son moi » (le pulsionnel), en vient à faire le siège du praticien en vue d’obtenir qu’il la possède sexuellement.[5]
Nous voici dans un moment clinique où :
- un refoulement pulsionnel « saute » du côté du patient, et c’est ce qui est visé par l’analyse et l’analyste, et induit par la situation analytique ; un pulsionnel qui réclame l’immédiateté de la satisfaction,
- mais aussi dans la clinique du praticien, c’est-à-dire côté de son angoisse et ses défenses (sources de son contre-transfert) et le risque que ses élaborations ou refoulements sautent eux aussi ;
- moment qui s’oppose à la visée analytique, qui suspend la dynamique de la cure : un moment de résistance, ce qui peut être aussi le but du transfert amoureux : arrêter le mouvement de cure. Donc ici comme obstacle.
b : Puis le transfert amoureux comme nécessaire au travail analytique
C’est un peu plus tard que le transfert amoureux, après avoir été un obstacle, une résistance à la cure voire une contre-indication, devint une nécessité, une condition sine qua non de la cure analytique. Cela est indiqué au fil des écrits sur La technique psychanalytique et se rassemble dans les « Observations sur l’amour de transfert ». Si cet amour de transfert vient à faire défaut, la cure risque d’être, pour Freud, un échec.
Cette pensée est à la source de l’idée selon laquelle que la cure analytique serait impossible avec le psychotique :
- parce qu’il est décrit comme trop narcissique et ainsi incapable d’aimer un autre (que lui-même) ;
- mais on trouve aussi dans les écrits que l’état amoureux est le prototype normal de la psychose, car l’investissement de l’objet d’amour produit une forme extrême de désinvestissement du moi…
Peu clair tout cela, mais ce qui est à retenir est la circulation des investissements : si j’aime un autre, je désinvestis et appauvris une partie de ma libido narcissique pour la placer dans l’autre qui est alors surestimé.
C’est cet aspect qui fit passer de la conception du transfert comme obstacle au transfert comme « outil », et ainsi la nécessité du transfert amoureux comme moteur de la cure. Ce qui fit adresser par Freud une lettre à Emma Eckstein en 1905 pour lui expliquer – ou justifier ? – l’échec de sa cure : « l’amour n’était pas apparu » ; de même, c’est ce qu’il dit avec force à Hilda Doolittle, frappant du poing l’appui-tête du divan : « vous ne pensez pas qu’il vaut la peine de m’aimer » ou encore avec Dora ou la jeune homosexuelle.
La « justification » de ce transfert amoureux est technique – et pas forcément narcissique- : la situation analytique doit permettre ainsi d’échanger le « matériel contre le psychique », c’est-à-dire du pulsionnel ou du fantasmatique contre de la perlaboration, et amener le patient à devenir sensible à autre chose qu’« à la logique de la soupe et aux arguments des quenelles ».[6]
c : Enfin, nécessité crée par le dispositif analytique
Tout semble être du coté des patients, de leurs résistances ou de leurs incapacités (et non pas d’une problématique !) C’est dans ses « Observations sur l’amour de transfert » que Freud reconnaît que c’est la situation analytique qui crée le phénomène et pas tant l’analyste ou ses attentes (pas tant ou pas toujours). Du coup, l’analyste n’a ni à s’enfuir (comme Breuer face à Anna O.), ni à céder pour quelques raisons narcissiques ou fantasmatiques à cet amour transféré. Freud ici inscrit les amours de transfert non plus comme obstacles ou incidents, mais comme outil, moteur et nécessité de la cure. De ne pas l’entendre ainsi est un composant du contre-transfert, et c’est pour cela que c’est en référence au travail de l’analyste que Freud utilise l’expression de contre-transfert :
« D’autres innovations d’ordre technique intéressent la personne même du médecin. Notre attention s’est portée sur le « contre-transfert » qui s’établit chez le médecin par suite de l’influence qu’exerce le patient sur les sentiments inconscients de son analyste. »[7]
d : ou l’analyste
En 1915, dans « Observations sur l’amour de transfert », Freud fait usage à nouveau du terme contre-transfert. Il traite alors cette question sous l’angle de la relation entre un analyste et une patiente. Il s’agit, dit-il, d’une situation fréquente : celle du cas où une patiente est amoureuse de son analyste. En fait, dans tout traitement psychanalytique s’établit, sans que le médecin ne fasse rien pour cela, une intense relation affective du patient à la personne de l’analyste. Freud ne nie pas que l’analyste puisse être touché par le contre-transfert, mais il ne lui reconnaît pas à ce moment-là de valeur quant à la dynamique de la cure. Sa formulation du contre-transfert répond d’abord d’une définition économique de la dépense d’énergie épargnée. Il donne alors des recommandations. Il souligne
« […] que tout analyste ne peut mener à bien ses traitements qu’autant que ses propres complexes et ses résistances intérieures le lui permettent. »[8]
Ce qui a pour corollaire la nécessité pour l’analyste de se soumettre à une analyse personnelle. Pour Freud la position de l’analyste est la méfiance :
« Pour le médecin, ce fait constitue un précieux enseignement et un avertissement salutaire d’avoir à se méfier d’un contre-transfert peut-être possible. »[9]
Le début de la phrase semble aller dans le sens du contre-transfert comme instrument de connaissance du transfert du patient. Mais la seconde proposition ramène à une conception défensive. Ce que Freud reconnaît (enfin) dans ses « Écrits techniques » : c’est l’analyste qui met le feu. Notons l’emploi des métaphores de feu : le « feu au théâtre », le « baptême du feu », « être roussi au feu de l’amour », etc. Ce qui vient mettre en avant la question du transfert de l’analyste.
Ainsi il y a deux éléments à relever :
- l’analyste met le feu en autorisant et accueillent sans jugements (pas de position surmoïque et morale) ;
- et la situation elle-même via l’intimité crée au fil des séances.
Du coup apparaît une règle :
« Le traitement doit se pratiquer dans l’abstinence… pas seulement physique… il faut laisser subsister chez le malade besoins et désirs, parce que ce sont là des forces motrices favorisant le travail et le changement. Il n’est pas souhaitable que ces forces se trouvent diminuées par des succédanés de satisfactions ».
L’abstinence : afin de laisser venir ce qui a été refoulé, sinon, tout passage à l’acte s’opposera à ce mouvement et maintiendra le refoulement et ses répétitions.
Donc, pas une règle surmoïque, mais une indication technique qui mettra en avant l’importance de la frustration dans la cure (qui sera longtemps un procédé majeur) en ce que cette frustration va amener à élaborer plus mentalement fantasmes et désirs.
Cette abstinence n’est pas sans effets chez l’analyste lui-même. En effet, Freud fit l’observation suivante : les manifestations d’hostilité et de partialité des analystes entre eux montrent qu’ils utilisent des défenses qui détournent de leurs personnes et dirigent sur d’autres des exigences de l’analyse et restent ainsi comme ils sont, se soustrayant à « l’influence critique et corrective de l’analyse ». C’est à ce sujet que Freud emploie l’analogie avec les rayons Roentgen. Mais il ajoute :
« … chez l’analyste lui-même, du fait du commerce incessant avec tout le refoulé qui, dans l’âme humaine, lutte pour sa libération, se voient arrachées à leur sommeil toutes ces revendications pulsionnelles qu’il peut habituellement maintenir dans l’état de répression. Ce sont là aussi des dangers de l’analyse ».
Et ces revendications vont se jouer sur une autre scène, extérieure à la séance : entre collègues, dans les institutions, la famille, etc.
e : 1915, définition du transfert
C’est dans « La technique Psychanalytique » que Freud donne une définition du transfert qui n’est plus un effet de manque d’élaboration ou une simple projection pulsionnelle, voire une résistance, mais une « autre scène », une « scène B »[10] où quelque chose d’autre vient se mettre en jeu, et cet autre chose est une « scène A » refoulée : c’est la relation aux figures parentales qui est rejouée et revécue dans le transfert. Ceci fait du transfert un processus organisant l’ensemble de la cure sur le prototype des conflits infantiles.
Cela aboutit au dégagement d’une notion nouvelle, celle de névrose de transfert, c’est-à-dire l’espace même de la cure comme scène[11] :
« […] nous réussissons à conférer à tous les symptômes morbides une signification de transfert nouvelle, et à remplacer sa névrose ordinaire par une névrose de transfert dont le travail thérapeutique va le guérir »[12]
Ainsi des fragments de l’histoire infantile vont être mis en scène, répétés et se jouer dans cette scène seconde qu’est l’espace de la cure. Ceci grâce aux processus de remémoration, répétition et perlaboration.
Note : on voit bien qu’une obéissance au cadre ne serait que répéter une soumission surmoïque (et parentale) répétant des exigences de refoulement chez l’analyste et en cela s’opposerait au travail et au moteur même de l’analyse. Et c’est souvent ce qui circule avec la notion de « cadre » telle que certaines institutions la font fonctionner : il y a à s’y soumettre sans autre forme de compréhension et surtout, sans autre forme d’élaboration.
2 : Puis l’apparition de la notion de contre-transfert comme obstacle
Lorsque Jung interpelle Freud au sujet de « l’accident » dans la cure d’une patiente (voir infra), ce dernier lui répond ceci en 1909 :
« Je ne me suis moi- même jamais laissé prendre aussi sérieusement, mais j’y ai touché de très près plusieurs fois et m’en suis tiré de justesse[13]. Je suis persuadé que ce ne sont que les dures nécessitées qui pesaient sur mon travail, et le fait que j’avais dix ans de plus lorsque je suis arrivé à la psychanalyse qui m’ont sauvé d’expériences similaires. Mais celles-ci ne causent aucun tort durable. Elles nous, aident à développer l’armure protectrice dont nous avons besoin et à dominer le « contre-transfert », qui est, après tout, un problème permanent pour nous tous. »[14]
Pour l’instant, le contre-transfert est pour Freud une :
« nécessité de cette expérience pour les progrès de l’analyse »[15].
La raison ?
« … plus un individu est amoureux, plus il est généralement dépendant de l’objet sexuel. En effet, on peut faire dériver de là une règle importante pour l’analyse : tandis que le patient s’attache au médecin, le médecin est sujet à un processus similaire, celui du contre-transfert ». Ce contre-transfert doit être complètement surmonté par le médecin ; cela seul le rend maître de la situation analytique ; cela fait de lui l’objet complètement froid que l’autre personne doit courtiser avec amour. »
(Une note précise qu’il est dit que Freud découvrit le contre-transfert avec un patient phobique)[16].
Un an après, il adresse ceci à Jung :
« La C.[17] m’a raconté toutes sortes de choses sur vous et sur Pfister, si l’on peut appeler raconter ces allusions continuelles, desquelles je conclus que vous deux n’avez pas encore acquis dans la pratique la froideur nécessaire, que vous engagez encore et que vous donnez beaucoup de votre propre personne, pour demander quelque chose en retour. Puis-je, en digne maître, vous avertir qu’avec cette technique on fait régulièrement un mauvais calcul, qu’il faut bien plutôt rester inaccessible, et se borner à recevoir ? Ne nous laissons jamais rendre fous par les pauvres névrosés. L’essai sur le « contre-transfert », qui me semble nécessaire, ne devrait pas être imprimé, mais circuler parmi nous en copies. »[18]
Quand même, le phénomène doit rester secret, entre nous… et ce sera répété et écrit. Par exemple en 1912, dans les « Conseils aux médecins » : le contre-transfert est un obstacle et il faut garder cela secret…
Un autre aspect va progressivement émerger : le contre-transfert a une certaine importance, car s’il n’y a pas ce transfert, on est dans la morale : la morale comme contre-transfert et inversement : la morale signe un contre-transfert : le transfert positif de l’analyste envers son patient permet d’entendre, accueillir l’immoral[19].
Notons que l’on énonce rarement cela : le transfert de l’analyste sur son patient, positif ou négatif, le tout noyé dans la notion de contre-transfert alors que ce n’est pas la même chose, ou, pire, dans cette formulation selon laquelle, l’analyste ayant été analysé et formé, ne ferait aucun transfert…
C’est en ce sens, Freud conseille-t-il Binswanger en 1913 :
« Le problème du contre-transfert que vous évoquez est un des plus difficiles de la technique psychanalytique. Théoriquement il est, je pense, plus facile à résoudre. Ce qu’on donne au patient ne doit jamais être un affect spontané, mais doit toujours être consciemment exprimé, en plus ou moins grande quantité selon les besoins. Dans certaines circonstances, il faut donner beaucoup, mais jamais rien qui soit issu directement de l’inconscient de l’analyste. Pour moi, c’est la règle. On doit chaque fois reconnaître et dépasser son contre-transfert, pour être libre soi-même. Donner trop peu à quelqu’un parce qu’on l’aime trop, c’est faire du tort au malade, et c’est une faute technique.
Tout cela n’est pas facile et peut-être faut-il un peu plus d’expérience. »[20]
Il s’agit donc de donner beaucoup mais jamais « du propre inconscient », c’est une question de maîtrise…
Mais ce qui revient le plus souvent dans les textes est bien qu’il s’agit d’un danger à éviter, face auquel seule l’abstinence est la règle…[21] sans doute suite, entre autres, à l’histoire entre Elma Palos et Ferenczi (voir infra).
C’est en 1915 que tout cela est rassemblé dans le texte des « Observations sur l’amour de transfert ».
Lorsque le patient opère un transfert amoureux, l’analyste pense aux solutions suivantes :
- une narcissique : voici une union durable et légitime (sans doute illustré par Gizella Palos et Ferenczi) ;
- mais le plus souvent, il y a séparation par arrêt de la cure (Sabina et Jung) : le passage à l’acte sexuel vient interrompre l’échange de paroles dont un des moteurs est justement la frustration sexuelle dans certains cas ;
- il peut se présenter la solution de nœuds illégitimes et non-éternels, solution à laquelle s’opposent et la dignité médicale, et la morale bourgeoise (ce sont les deux arguments que Jung avance à Freud, pour résister à la « polygamie » que préconise aussi bien Eitingon qu’Otto Gross, adhérant au mouvement de la Bohème de l’époque) ;
- impossibilité de moyens termes, tels que partager les tendres sentiments sans manifestations physiques ;
- mais il n’y a qu’une solution psychanalytique : se méfier du contre-transfert (ici, c’est bien au sens du Gegenliebe) car cet amour est déterminé par la situation analytique et non quelques avantages personnels. L’analyste doit se poser en « champion de la pureté des mœurs et de la nécessité du renoncement », en remplaçant les décrets de la morale par les égards dus à la technique.
1922, au congrès de Berlin le contre-transfert comme réaction thérapeutique négative : se remettre constamment en question…
3 : Puis le contre-transfert comme obstacle
L’analyste doit se garder de donner satisfaction au patient car il y a à se méfier d’un possible contre-transfert :
« […] le traitement doit se pratiquer dans l’abstinence. »
Freud donne des conseils de prudence, appelle à la mise en garde contre l’amour de transfert, préconise la froideur des sentiments.
« Pour l’analysé, le médecin doit demeurer impénétrable et, à la manière d’un miroir, ne faire que refléter ce qu’on lui montre.
Pratiquement, il est vrai, l’on ne saurait s’opposer à ce qu’un psychothérapeute combine une certaine dose d’analyse à quelque traitement par suggestion, dans le but d’obtenir plus rapidement un résultat thérapeutique patent, comme, par exemple, dans les maisons de santé, mais alors ce praticien doit se rendre compte lui-même de ce qu’il fait et ne pas confondre sa méthode avec une psychanalyse véritable. »5 Freud donne la recommandation suivante :
« Pour que le médecin soit capable de se servir ainsi de son propre inconscient comme d’un instrument, il lui faut se soumettre dans une large mesure, à une certaine condition psychologique. Il ne doit tolérer en lui-même aucune résistance susceptible d’empêcher les perceptions de son inconscient d’arriver jusqu’à son conscient, sinon il introduirait dans l’analyse une nouvelle sorte de sélection et de déformation bien plus néfaste que celle provoquée par un effort de son attention « consciente. Il ne suffit pas, pour cela, que le médecin soit à peu près normal, il doit avoir pris connaissance de ses propres complexes qui risqueraient de gêner sa compréhension des propos de l’analysé. »6
« Neutralité analytique » Freud parlait d’être amical, freundlich avec « Wohlwillen » (vouloir le Bon ou le Bien, Wohl en allemand). Et la règle pour lui, c’était celle de l’indifférence et de l’abstinence sexuelle.
« Il ne faut en aucun cas se départir de l’indifférence que l’on avait conquise en tenant de court le contre-transfert. »
Ce qui n’est pas de la « neutralité », qui est une invention anglaise introduite par Strachey.
La correspondance fait cependant apparaître le mot « neutralité » à propos des Suisses, pendant la guerre.
Notes
[1] Aldous Huxley, Les diables de Loudun, Pocket, 1993.
[2] « Tomber amoureux, se prendre d’amour pour une personne ».
[3] Sigmund Freud, « Etudes sur l‘hystérie » (1895), in OCP-F, Tome II, PUF, 2009, p. 330.
[4] Ibid., § IV, « Psychothérapie de l’hystérie », III, 3°), p. 330.
[5] 1915, « Observations sur l’amour de transfert ». Voir la description de Victor Méric in Les compagnons de l’Escopette, Ed. de l’Épi, Paris, 1930, p. 118 : « Elle était la femelle primitive, la guerrière énamourée, avec tout l’apport des cérébralités vicieuses superposées par couches brûlantes depuis des siècles que sévit l’imbécile mysticisme ennemi de l’acte brutal et simple. »
[6] L’amour de transfert, PUF p 122 – 125.
[7] « La technique psychanalytique » p.27.
[8] « La technique psychanalytique » p.27.
[9] « La technique psychanalytique » p. 122.
[10] Neurotica
[11] Voir Rank, la scène dans la scène
[12] « La technique psychanalytique », p. l 13.
[13] narrow escape, en anglais dans le texte
[14] Mc Guire, 1974
[15] 30 X 1910, « Les chances futures de la thérapie psychanalytique »
[16] Minutes II 9 mars 1910 pp. 436-437 :
[17] Sabina Spielrein.
[18] Le 30 XII 1911, Freud écrit ceci à Jung (lettre 290F) :
[19] Minutes II sur Nietzsche
[20] Binswanger 20 février 1913 p. 183 :
[21] 1915, in « Remarques sur l’amour de transfert »