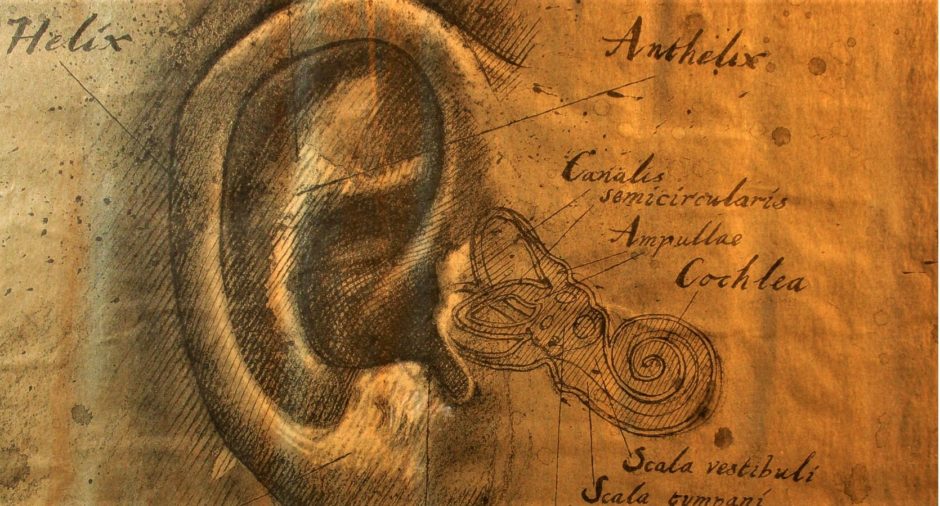Le terme de renoncement a, en français, une connotation éminemment religieuse, indiquant un impératif moral, surmoïque, visant à une purification de l’âme qui n’existe pas dans l’esprit de Freud : il s’agirait plutôt d’une sorte de purgation de la psyché[1]. En tous cas, le renoncement au sens de Freud n’est pas un impératif moral, même s’il est lié à une éthique de l’analyste ; et encore moins quant au patient ! Par ailleurs, ce terme n’a pas reçu une place claire et fixe dans le lexique de Freud dans la mesure où il apparaît à divers moments et divers lieux dans le système perception-conscience.
a – Le renoncement face au réel
Dans l’Interprétation des rêves, Freud énonce quelques exemples de jugements d’impossibilité, c’est-à-dire de renoncements imposés par le réel et sa contrainte (externe) : Realforderung. Par exemple, il est impossible :
– d’avoir le même âge que son père,
– que les enfants soient manufacturés,
– de naître deux fois,
– d’épouser autant de femmes que de membres de la famille,
– que ma sœur ne soit pas ma sœur,
– le passé ne revient pas,
– et d’échapper au fait que l’on doit une mort à la nature.
Autant de jugements que les fantasmes – et une grande part de la pathologie – peuvent réfuter, non sans apporter, en prime, une satisfaction préliminaire (Vorlust) toute imaginaire. Ce qui vient mettre en opposition fondamentale la puissance de cet imaginaire face à la réalité externe et son épreuve, son éprouvé de frustrations[2], opposition qui va composer la réalité psychique. C’est sur cela que l’invention de la psychanalyse va, entre autres choses, porter : le renoncement aux satisfactions pulsionnelles (sur le mode hallucinatoire du fantasme, par exemple, indépendamment de la réalité), c’est-à-dire l’idéal d’un renoncement au monde de la réalité psychique pour l’admission de celui de la « réalité réelle ».
b – Le renoncement névrotique
Mais les renoncements obtenus par la cure sont différents de ceux imposés par les conflits névrotiques, sources de souffrance et de plainte : nous devrions dire, dans ce cas, qu’il s’agit de renoncements liés à la formation d’un compromis et d’une contrainte interne (celles du ça et du surmoi par exemple). Ainsi, Freud a pu indiquer deux modes de renoncement à la satisfaction pulsionnelle :
– Par peur de la punition, celle de la castration : le danger menace tout le moi du fait de son identification aux organes génitaux (la partie – fétichisée – pour le tout, c’est une Weltanschauung reposant sur des théories sexuelles infantiles) ;
– Mais aussi par peur de perdre l’objet aimé ou l’amour de l’objet : alors le sujet absorbe l’objet en son moi et l’investit de libido, il devient une partie du moi sous la forme de l’idéal du moi[3]. Le moi se soumet à l’idéal par amour (et non par obéissance comme face au surmoi). L’idéal du moi est l’image dans le moi des objets aimés. Ici, l’on retrouve l’idéal de vie de Dilthey.
c – Le renoncement comme effet de l’analyse
Nous pourrions faire une longue liste de ce que Freud pose comme renoncements acquis au cours d’une analyse. En parcourant ses écrits, nous pouvons en relever quelques-uns, dont certains sont tout à fait sujets à discussion. Exemple de renoncements :
– à la sexualité infantile et aux théories sexuelles infantiles ;
– à la mère pour le père ;
– au clitoris pour le vagin comme condition d’accès à la féminité – selon Freud ;
– au principe de plaisir pour celui de la réalité et donc renoncement au fantasme et autres élaborations secondaires ; et au-delà, renoncement à la toute-puissance de la pensée ;
– aux bénéfices secondaires de la maladie et du symptôme.
Mais en quoi ces renoncements se différencient-ils de ceux de la névrose ? Une indication, pouvant éclairer la pensée de Freud sur ce thème, apparaît plusieurs fois dans les Minutes de la Société Viennoise de Psychanalyse : le but à atteindre serait celui d’une répression[4] qui serait un « refoulement conscient » par opposition au refoulement inconscient dont le résultat est une censure. Car, en fait, ce n’est pas le refoulement qui est à l’origine de la névrose, mais son échec[5]. Et c’est cet échec qui produit les symptômes car l’échec du refoulement, et donc le retour du refoulé, entraîne une formation de compromis. Il y a donc à prendre conscience du refoulement de la sexualité et apprendre à la subordonner aux nécessités de la réalité (l’Ananké freudienne) et de la culture (par exemple, en déplaçant la sexualité vers la soif de savoir, source de toute recherche intellectuelle). Ainsi la psychanalyse aiderait à remplacer le refoulement par une répression normale et consciente. Ce qu’indique ici Freud, en 1906, est une opération consciente du sujet, c’est-à-dire non pas imposée par la nécessité ou pour protection, ni une opération à son insu : mais bien celle d’un sujet admettant ses motions pulsionnelles en un moi qui ne serait plus le jouet du ça, du surmoi et du monde externe, les trois tyrans du moi névrosé. Et ce moi serait le maître dans sa maison, jugerait ces motions pulsionnelles à l’aune des réalités (par l’épreuve de la réalité), et selon, pourrait les repousser sans refouler, ce qui supprime la formation de symptômes.
Une autre indication freudienne de renoncement est posée, elle aussi, comme une « visée » de l’analyse : le narcissisme (être amoureux de soi, c’est-à-dire de ses propres organes génitaux) est un stade obligé entre l’auto-érotisme et l’amour d’objet. L’être a ainsi deux objets sexuels premiers : la femme (mère, nurse, etc.) et soi-même, objets auxquels il doit renoncer[6].
d – Le renoncement comme éthique scientifique du psychanalyste
Le renoncement à opérer, tel un travail de deuil, est indissociable de l’épreuve de réalité, selon le jugement d’existence[7]. Freud pensait le psychanalyste comme « scientifique », ni croyant, ni médecin, ni philosophe[8], au sens d’un sujet acceptant le fragmentaire et renonçant aux visions d’ensemble : « J’ai un talent particulier pour le contentement fragmentaire »[9]. Définition qui, lorsque l’on fait un tour d’horizon, particulièrement en France, semble plus que perdue de vue sinon largement bafouée : psychologie et médecine ont récupéré la psychanalyse pour n’en faire qu’une technique. De là, sans doute, un certain malaise de la psychanalyse…
Le fragmentaire est l’effet des épreuves successives de la réalité : fragment par fragment, est ce qui définit l’avancée de la science analytique et du scientifique, ce qui exclut la saisie ou l’élaboration d’un Tout. Si la représentation recherchée ne peut être retrouvée dans la réalité, alors elle doit être abandonnée. L’on sait ainsi les nombreux renoncements qui jalonnent l’œuvre de Freud. L’on sait bien qu’il n’hésitait pas à mettre en question sa théorie, et donc sa personne propre, lorsque quelque élément faisant retour via la cure ne trouvait ni place, ni explication : soit lorsque la réalité (clinique) venait contredire la théorie – et non pas sur le plan d’une négation interne, par contrainte interne, Anspruch, ou dans le fantasme, mais bien externe, Realforderung. Pour donner quelques exemples de ces renoncements :
– Avril 1885 : « Le grand tournant de ma vie » et la destruction de quatorze ans de notes. « J’avais écrit beaucoup de notes, elles s’entassent autour de vous comme des sables mouvants autour du sphinx »[10].
– Puis en septembre 1897 le célèbre renoncement à la Neurotica, c’est-à-dire à la théorie de la séduction qui permit le repérage du Proton pseudos, soit le fantasme et la réalité psychique[11].
– Mars 1900 et la démolition des châteaux en Espagne.
– 1915 : destruction des articles de la Métapsychologie, etc.
Et c’est ainsi que la position scientifique n’est possible qu’au prix d’un renoncement aux exigences narcissiques, et la reconnaissance de sa petitesse par la soumission aux nécessités naturelles : « La science ne constitue-t-elle pas le plus parfait renoncement au principe de plaisir dont notre travail psychique soit capable ? »[12].
De même en chaque cure : la psychanalyse est sans cesse à réinventer, jamais achevée en tant que technique, ce qui n’est pas une position économique ! Renoncement bien difficile puisque l’on voit des analystes rigidifier un cadre, une technique, voire revenir (régresser) à des méthodes plus économiques comme l’hypnose, les conceptions behaviouristes (le cognitivisme par exemple), les grilles d’interprétation, etc.
Car, attention, il y a des faux renoncements, c’est-à-dire en fait de simples déplacements : « … Nous ne pouvons renoncer à rien, nous ne faisons que remplacer [vertreten[13]] une chose par une autre ; ce qui paraît être un renoncement est en réalité une formation substitutive ou un succédané »[14]. Un bel exemple est celui que donne Freud dans son texte sur Vinci :
– l’apparent renoncement au père n’est qu’un déplacement : du père au Père Noël, puis au Maître, puis à Dieu ou le Président, etc. ;
– quant au déplacement de la mère il peut se faire sur la Vierge Marie ou la Nature, etc.
La croyance (religieuse, politique, scientifique, etc.) n’est qu’un déplacement de la problématique œdipienne et donc un masque de non renoncement.
Enfin, nous pourrions conclure avec Heidegger :
« Le renoncement ne prend pas, mais il donne »[15].
[1] Nous jouons sur les deux sens du mot grec (et allemand) Katharsis : soit la purification au sens religieux, soit la purgation au sens médical. A ce sujet, voir J. Bernat, Le processus psychique et le théorie freudienne, coll. « Études Psychanalytiques », L’Harmattan, 1996.
[2] Par exemple, la lettre de Freud du 13-VIII-1937 à M. Bonaparte in Correspondance générale, Paris, Gallimard, 1979 : « Dès qu’on s’interroge sur le sens et la valeur de la vie, on est malade, car ni l’un ni l’autre n’existent objectivement ; on avoue simplement posséder une réserve de libido insatisfaite, à laquelle quelque chose a dû arriver, une sorte de fermentation aboutissant à de la tristesse et de la séparation. ».
[3] Voir Herman Nunberg, Principes de psychanalyse, PUF, 1957, pp. 155-156.
[4] Minutes de la Société Viennoise de Psychanalyse, I, p. 46, Gallimard, 1975.
[5] Ibid., p. 96.
[6] Voir la séance du 10 novembre 1909, Minutes de la Société Viennoise de Psychanalyse, II, Gallimard, 1976, p. 307.
[7] Voir J. Bernat, « Deux éléments épistémologiques de l’expérience psychanalytique : intuition et conviction », in Le Mouvement Psychanalytique, IV, 1, 2002, L’Harmattan.
[8] Voir la Correspondance avec le pasteur Pfister, 1909-1939, Gallimard, 1966.
[9] S. Freud, lettre à G. Groddeck du 17-IV-1921, Ça et moi, Paris, Gallimard, 1977, p. 70-71 : telle est la réponse de Freud face au monisme de Groddeck représenté par sa conception du ça comme Un de la psyché.
[10] S. Freud, Correspondance générale, Gallimard, 1979, lettre à Martha, p. 152.
[11] In La naissance de la psychanalyse, P.U.F., 1969, p. 190 : « Je ne crois plus à ma Neurotica (…) il y eut d’abord les déceptions répétées que je subis lors de mes tentatives pour pousser mes analyses jusqu’à leur achèvement, la fuite des gens dont les cas semblaient le mieux se prêter à ce traitement, l’absence du succès total que j’escomptais (…) ».
[12] Freud S., (1910) « Un type particulier du choix d’objet chez l’homme », in La vie sexuelle, op. cit., p. 48.
[13] Voir J. Bernat, « Deux éléments épistémologiques de l’expérience psychanalytique : intuition et conviction », op. cit.
[14] S. Freud, « Le créateur littéraire et la fantaisie » in L’inquiétante étrangeté, Paris, Gallimard, 1985, p. 36.
[15] Heidegger M., « Le chemin de campagne » (Der Ferweld), Questions III & IV, collection Tel, Gallimard 1990.